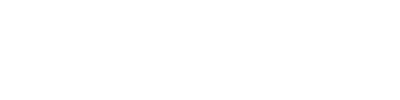Divers
Villefranche Cendrars
Au soleil de Villefranche,
par Frédéric Jacques Temple
En 1948, j’eus l’audace des timides en demandant à des écrivains pour qui j’avais de l’estime ou de l’admiration de m’aider à ranimer une très modeste revue montpelliéraine. Seuls, Jean Giono et Blaise Cendrars me répondirent en me donnant, le premier une nouvelle (« débrouillez-vous, trouvez le titre »), le second un chapitre du Lotissement du ciel, livre à peine terminé. Ils n’avaient rien exigé. Peu leur importait de savoir qui j’étais, en compagnie de qui ils seraient au sommaire. Et Cendrars avait ajouté : « Si vous venez un jour, ayez la bonté de prévenir à cause du ravitaillement ». En échange, il me suggérait de publier dans un prochain numéro les poèmes d’un jeune homme qui, écrivait-il, « vit tout seul au fin fond de l’Afrique Équatoriale. Vous ferez ainsi la joie d’un poète perdu ».
Je me suis demandé ce qui avait poussé Cendrars à me faire ce royal cadeau. J’en suis arrivé à penser que, sans doute, il m’avait relié dans le secret de son cœur à son fils Rémy qui venait de s’écraser avec son avion. Je sortais de la guerre, rescapé de la mitraille, tout juste délivré des tanks, des mines et des obus. Je lui avais parlé de Naples où il avait vécu dans son enfance, de l’hiver dans les trous d’eau des Abruzzes, du bombardement du Monte-Cassino, de la boue et du sang. Invalide de la première guerre, souffrant toujours de son bras coupé, Cendrars, père meurtri dans la deuxième, ne pouvait rester indifférent devant ce jeune ancien combattant. Nos épreuves communes avaient compté davantage que des considérations plus ou moins oiseuses sur les poètes et la poésie.
Après avoir publié ce chapitre, Le Ravissement d’amour, ce dont il me remercia par cette dédicace : « À vous, mon cher Temple, mon éditeur princeps », je me décidai à donner suite à son invitation. Le 3 juillet 1949, un ami qui allait en Italie me déposa sur le quai de Villefranche-sur-Mer. Dans la rade, mouillaient des unités de la flotte américaine. C’était la fête. Sans m’y attarder, je volai, je planai vers le domaine de Saint-Segond à l’abri du vacarme. Pour y parvenir, il fallait gravir, sous la canicule, un interminable raidillon empourpré de bougainvillées, et enfin apercevoir, au-delà d’un portail, une maison entourée de cyprès. J’étais essoufflé, inondé de sueur. Après avoir calmé ma respiration, je sonnai. À l’étage, apparut à une fenêtre un torse puissant surmonté d’une tête de flibustier. J’étais bien là, devant cet homme admiré, mais dont j’avais redouté l’examen de passage. Et si, après coup, il avait regretté son geste ? Qu’étais-je avec ma si pâle revue ? J’étais là, trempé de sueur, dans l’attente du verdict. J’entendis crier : « J’arrive ! » Quelques secondes plus tard, je serrai enfin la légendaire main amie…
Extrait de l’ouvrage : Balade à Nice, sur les pas des écrivains (c) Alexandrines, avril 2012